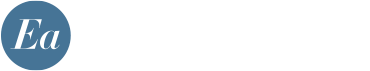Editorial Septembre
Chers collègues, chers amis,
Pour cette nouvelle rentrée, il me paraît essentiel de souligner la vitalité et l’actualité de la pensée de Lacan. Ce dernier doit demeurer une référence, non seulement pour les psychanalystes, mais également pour tous ceux qui se questionnent sur les nouveaux visages que revêt le malaise dans nos sociétés contemporaines. En effet, homme du XXe siècle, Lacan a formulé des hypothèses, des propositions qui, aujourd’hui, s’avèrent opératoires pour déchiffrer les symptômes que manifeste la civilisation occidentale au XXIe siècle. Il importe toutefois de préciser que le terme de prédiction pourrait laisser supposer que Lacan possédait un don de divination, ce qui serait totalement erroné. En réalité, Lacan fondait ses conjectures sur la logique et ses lois, ainsi que sur les structures fondamentales qui gouvernent la subjectivité humaine : un sujet ontologiquement indéfinissable, qui n’est pas une substance, qui ne peut faire l’objet d’un savoir, tout en étant sa condition première. Autrement dit, il s’agit d’un sujet qui n’est pas celui du Cogito cartésien, ni du Dasein heideggerien, ni le sujet de l’intersubjectivité, ni même le sujet de l’énonciation du rêve, mais qui constitue une simple supposition permettant de faire tenir ensemble la chaîne des signifiants inconscients. Lacan ne se contentait pas d’émettre des prédictions, il attachait une importance cruciale au fait de les dire, car il considérait qu’elles portaient en elles une vérité. À ce titre, il rejoignait Freud qui, évoquant la participation sexuelle à l’étiologie de l’hystérie, s’interrogeait à propos des médecins : « Puisqu’ils le savent, pourquoi ne le disent-ils pas ? ».
Chers collègues, chers amis,
Pour cette nouvelle rentrée, il me paraît essentiel de souligner la vitalité et l’actualité de la pensée de Lacan. Ce dernier doit demeurer une référence, non seulement pour les psychanalystes, mais également pour tous ceux qui se questionnent sur les nouveaux visages que revêt le malaise dans nos sociétés contemporaines. En effet, homme du XXe siècle, Lacan a formulé des hypothèses, des propositions qui, aujourd’hui, s’avèrent opératoires pour déchiffrer les symptômes que manifeste la civilisation occidentale au XXIe siècle. Il importe toutefois de préciser que le terme de prédiction pourrait laisser supposer que Lacan possédait un don de divination, ce qui serait totalement erroné. En réalité, Lacan fondait ses conjectures sur la logique et ses lois, ainsi que sur les structures fondamentales qui gouvernent la subjectivité humaine : un sujet ontologiquement indéfinissable, qui n’est pas une substance, qui ne peut faire l’objet d’un savoir, tout en étant sa condition première. Autrement dit, il s’agit d’un sujet qui n’est pas celui du Cogito cartésien, ni du Dasein heideggerien, ni le sujet de l’intersubjectivité, ni même le sujet de l’énonciation du rêve, mais qui constitue une simple supposition permettant de faire tenir ensemble la chaîne des signifiants inconscients. Lacan ne se contentait pas d’émettre des prédictions, il attachait une importance cruciale au fait de les dire, car il considérait qu’elles portaient en elles une vérité. À ce titre, il rejoignait Freud qui, évoquant la participation sexuelle à l’étiologie de l’hystérie, s’interrogeait à propos des médecins : « Puisqu’ils le savent, pourquoi ne le disent-ils pas ? ».
En tant que clinicien et observateur averti des jouissances, Lacan avait discerné précocement les prémices de l’évolution de la crise civilisationnelle. Il pensait que ces jouissances, modulées par l’impact du discours scientifique, finiraient par organiser leur coexistence au sein de la société par le biais de mécanismes tels que la ségrégation et le racisme — ce que constitue la prédiction évoquée dans « Télévision ». Celle-ci peut être comparée à l’analyse que Tocqueville faisait de l’inéluctable évolution des démocraties vers une égalité formelle des conditions. Si la coexistence des différents discours au sein du tissu social peut théoriquement s’effectuer, et peut se voir garantir une certaine égalité par le biais d’une justice distributive, il n’en va pas de même pour les jouissances. Au slogan de mai 1968, « Il est interdit d’interdire », Lacan opposait déjà la nécessité d’un ordre structuré : « Vous voulez un maître, vous l’obtiendrez. » Faute d’une justice distributive réellement effective, l’issue peut se trouver alors réduite à un choix binaire entre un dictateur semblant jouer le rôle de maître ou une guerre civile entre jouissances antagonistes.
Une autre prédiction de Lacan concerne le retour du religieux, qu’il qualifie de funeste. Il ne s’agit pas simplement de positionner la psychanalyse en opposition à la religion, mais d’affirmer qu’une autre clinique, distincte de celle des jouissances, existe — ou plutôt, que la clinique des jouissances se trouve complétée par celle de l’Autre. Ce lien entre ces deux jouissances est observable notamment chez l’obsessionnel et chez le paranoïaque. Lacan avançait l’hypothèse que les effets sociaux du discours de la science, à l’opposé de la psychanalyse, renforceraient la place de l’Autre et alimenteraient les phénomènes de croyance chez le sujet. Cette tendance est aisément repérable dans le champ médical, où l’on constate que, plus la médecine devient technique et scientifique, plus les patients recourent à des médecines parallèles fondées en grande partie sur la croyance. La psychanalyse peut, à cet égard, jouer un rôle spécifique en offrant une ouverture à ceux qui sont dans une attente croyante. Hélas, la psychanalyse se voit aujourd’hui confrontée à une opposition persistante. Son enseignement tend à disparaître dans les universités et dans la psychiatrie, faisant place à une psychologie comportementale, cognitive, quantitative, ainsi qu’à une psychiatrie DSM, statistique, réductionniste, scientiste et pharmacologique.
Divers autres courants de la psychanalyse ont entrepris d’explorer ces mêmes thèmes ; cependant, rien n’empêche qu’« Espace analytique » continue à les relayer, renouvelés dans son propre style.
Puissions-nous continuer, dans l’écoute clinique, la réflexion et la tâche que Freud définissait en termes de kulturarbeit, à faire vivre cette pensée vivante et à la mettre au service d’une compréhension toujours plus fine des enjeux de notre époque.
Patrick Landman
Septembre 2025