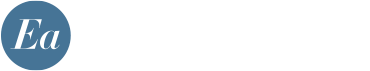Catherine Saladin, Comment lire aujourd’hui Maud Mannoni ?
Lire ou relire Maud Mannoni aujourd’hui, c’est effectuer un parcours à la fois historique et théorique dans la psychanalyse. Ses livres, ainsi que la collection qu’elle créa, abordent de nombreux sujets d’un point de vue critique, parmi lesquels : la politique de la santé mentale en France et dans le monde, l’éducation, la création de Bonneuil, la place des femmes, la question de la formation du psychanalyste… Maud Mannoni a été une fervente défenseuse des libertés, luttant contre toutes les formes de ségrégation.
Lors du colloque « Maud Mannoni hier et aujourd’hui » (22 septembre 2018), nous avons pu entendre la richesse de son œuvre, de son invention, de sa création et de son engagement. Il était juste de faire une place à son œuvre écrite, à ses propres publications aux éditions du Seuil, puis dans la collection « Espace analytique » qu’elle dirigea chez Denoël. J’ai souhaité parler de ces écrits si riches qui éclairent bon nombre de nos questions concernant aussi bien la pratique que la théorie psychanalytique.
L’engagement de Maud Mannoni à travers ces écrits est le propos du séminaire « Lire Maud Mannoni aujourd’hui » animé depuis 2019 par Olivier Douville, Maria Otero Rossi, Marie-Pierre Mansuy, Catherine Saladin, Martine Sgambato, Alain Vanier et Catherine Vanier, avec la collaboration de quelques collègues d’Espace analytique.
Maud Mannoni avait la passion de l’écriture, dont témoignent les nombreux livres exprimant sa pensée et son engagement. Elle a également publié divers auteurs dans sa collection, écrit des préfaces et des articles, répondu à des interviews et participé à plusieurs films et émissions de télévision et de radio.
J’en propose ici un recensement non exhaustif, avec des repères, des résumés et des indications permettant d’ouvrir sur des recherches plus approfondies. Je parlerai aussi des écrivains qui l’accompagnèrent.
Les premiers livres
Ils exposent l’expérience clinique de Maud Mannoni auprès des enfants et des parents, ainsi que les constructions théoriques qu’elle élabora à partir de ces rencontres.
Elle fut en analyse puis en contrôle avec Lacan, dont elle suivit l’enseignement et les séminaires. Elle fut également en contrôle avec Winnicott dont l’œuvre tient une place très importante chez elle, notamment concernant la place faite à l’invention et à la création, en s’appuyant sur les écrits freudiens autour de la fantaisie.
Pour parler de son apport inestimable, commençons par son premier livre :
L’enfant arriéré et sa mère (Seuil 1964)
Dans quel contexte ce livre fut-il publié ? Il inaugurait la collection « Le champ freudien » dirigée par Lacan aux éditions du Seuil. C’était deux ans avant la publication des Écrits de Lacan et l’année de la fondation de l’École freudienne, qu’elle allait rejoindre avec Octave Mannoni. C’était aussi l’année du séminaire de Lacan : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, dans lequel il invite son auditoire à lire ce livre de Maud Mannoni[1] .
En 1988, dans Ce qui manque à la vérité pour être dite, elle écrira : « Avec lui [Lacan] comme support, j’écris d’un seul trait L’Enfant arriéré et sa mère… Lacan m’autorise à articuler une expérience tâtonnante : sans lui, je n’aurais jamais trouvé les mots pour témoigner. »[2] Ce livre occupe donc une place à part.[3] Elle poursuit : « dans ce livre, publié en 1964, je mets en question l’abord de la débilité mentale, en interrogeant le mode selon lequel est vécue la débilité par l’enfant et sa famille […] Mon premier livre m’a permis de faire la lecture d’un trajet effectué avec les patients. Dans ce jeu d’échecs que constitue une analyse, j’acquiers, à travers l’écriture, une meilleure connaissance des effets des déplacements des pions. Ce livre, dédié à un père mort, parle essentiellement du passé. On peut dire qu’il me libéra, dans le présent, des arriérés. » Dans Le Symptôme et le savoir[4] (sa thèse de doctorat d’État, voir plus bas) elle parlera de la place de débile qui lui avait été attribuée dans sa famille. Elle se sentait de leur bord.
L’enfant arriéré et sa mère ouvre tout un champ de travail avec les enfants souffrant de handicaps mentaux. Il démontre qu’on peut entreprendre une psychanalyse avec ces enfants dits arriérés, qui en étaient jusque-là exclus au profit de la seule rééducation. Psychanalyse qui, si elle est entreprise assez tôt, permettra que l’enfant ne se fige pas dans sa position de débile. Pour Maud Mannoni, il est important de changer d’abord le type de relation au monde de ces enfants, cela leur donne plus de chance de bénéficier d’une rééducation spécialisée.
Il permet de comprendre la place que l’enfant occupe dans le fantasme maternel et quel discours collectif se tient à son propos. Maud Mannoni donne de précieuses indications sur la place du thérapeute. Son originalité est de reprendre ce dont Lacan parle dans sa théorie à propos des névrosés et des psychotiques, pour l’appliquer au champ de l’arriération mentale, c’est à dire de « l’inconscient structuré comme un discours ».
« La psychanalyse peut rendre à l’enfant sa dimension de sujet autonome. Il peut alors manifester des désirs qui lui sont propres », écrit-elle. On comprend à la lecture de ce livre magistral, quel rôle peut jouer la psychanalyse pour ces enfants-là, pour le travail auprès des familles. C’est un outil toujours actuel pour nous, psychanalystes.
Dans la conclusion, elle éclaire sa démarche, elle qui fut engagée et nous enjoignait d’être des militants de la psychanalyse. Rappelons qu’elle signa le Manifeste des 121 pour le droit à l’insoumission, pendant la guerre d’Algérie. Elle s’insurgeait contre toute forme de ségrégation : des enfants, des femmes, des fous. « Ce que j’ai voulu faire entrevoir, ce n’est pas tant une méthode de cure opposée à une autre, qu’un esprit nouveau face à l’être diminué, une manière d’approche radicalement “antiraciste” du problème humain. »[5]
On terminera par la question « Qu’est–ce qu’un débile ? », qu’elle laisse sans réponse, car pour elle, « ce qui compte, c’est de chercher, au-delà du déficient, la parole qui le constitue comme sujet en proie au désir » et, citant Lacan : « Si cette parole est accessible, c’est qu’aucune vraie parole n’est seulement parole du sujet, puisque c’est toujours à le fonder dans la médiation à un autre sujet qu’elle opère, et que par-là, elle est ouverte à la chaîne sans fin — mais non sans doute indéfinie, car elle se renferme — des paroles où se réalise concrètement, dans la communauté humaine, la dialectique de la reconnaissance. »
Tous ses premiers livres, jusqu’à la dissolution de l’École freudienne, furent publié au Seuil dans la collection du Champ freudien, excepté
Le premier rendez-vous avec le psychanalyste, écrit en 1965 à la demande de Colette Audry, préfacé par Françoise Dolto et publié chez Denoël Gonthier.
Ce petit livre est passionnant, par les témoignages des nombreuses consultations qu’elle mène et par l’analyse du rôle du psychanalyste par rapport au médecin et au rééducateur à qui elle accorde toute leur place. Maud Mannoni décrit une situation, celle des parents et de l’enfant, à partir de la première consultation. Que viennent-ils chercher ? des conseils ? un tiers qui prendra parti ? Au psychanalyste de ne pas se laisser piéger mais d’aider « un sujet à articuler sa demande ». Elle s’explique dans l’avant-propos sur des reproches qu’on pourrait lui faire sur le rôle de la mère : « si la mère peut paraître, à travers ces lignes, comme le seul support de toutes les fautes et de tous les crimes, il faut veiller à ne pas prendre à la lettre, au niveau du réel, ce que j’essaye souvent maladroitement de dégager comme accidents dans une topologie abstraite.[6] »
Que cela soit dans la réunion du lundi à Bonneuil, dans le travail de contrôle que jeunes analystes nous faisions avec elle, mais aussi dans les témoignages de parents, elle ne culpabilisait pas les parents et je peux en témoigner, car j’ai reçu des enfants de Bonneuil qu’elle m’adressait en analyse dans mon cabinet « car, disait-elle, cela laisse aux parents et à l’enfant la possibilité de critiquer Bonneuil, Mannoni, les éducateurs. Ils peuvent dire pis que pendre de l’institution. » Les parents, s’ils pouvaient critiquer telle ou telle chose de l’institution, se sentaient soutenus et écoutés par Maud Mannoni dans leur trajet pour que leur enfant puisse grandir, s’autonomiser et échapper à des institutions aliénantes.
Première consultation avec des enfants en échec scolaire, ce que la psychanalyse peut apporter, ou pas, selon la façon dont les parents et l’enfant, ou l’adolescent accepteront d’entendre une certaine vérité. Difficultés caractérielles, réactions somatiques, débuts d’une psychose, ces premiers entretiens articulent ce qui se passe lors de ce premier rendez-vous, si une psychanalyse peut être entreprise ou pas. Souvent, elle dit qu’il faut attendre, reporter la psychanalyse à plus tard, car elle n’entreprend rien si les parents ne sont pas prêts à entendre le sens que vient poser leur question à travers le symptôme de l’enfant, et à se mettre en question d’une certaine façon : « c’est dans une dialectique sur un plan relationnel que se livre le débat. » Ce livre situe le rôle du psychanalyste et l’importance du premier rendez-vous.
L’enfant sa « maladie » et les autres : Le symptôme et la parole (Seuil, 1967)
Elle organise la même année un grand colloque sur les psychoses en présence des représentants de l’antipsychiatrie Ronald Laing et Cooper.
C’est dans l’avant-propos qu’on trouve cette fameuse phrase : « La psychanalyse d’enfants, c’est la psychanalyse » qui ne manque pas de susciter des débats. Elle y reprend l’histoire de la psychanalyse d’enfants depuis Freud, avec l’exposé du « petit Hans », que Freud ne reçut qu’une fois avec son père. Et expose les différences entre Anna Freud, Mélanie Klein…
Elle reprend la question du transfert en psychanalyse avec les enfants, de la psychothérapie des psychoses, qu’elle illustre de nombreux cas cliniques. Elle insiste sur ce qui se passe dans le discours. C’est pourquoi elle entend les parents et l’enfant, et mène des cures avec l’enfant et l’un des parents : « Quand on oppose au discours du sujet la “réalité́”, c’est la “parole vraie” qui échappe, pour laisser la place à une parole ou à un masque trompeur, c’est à dire au symptôme qui demeure[7] » suivant en cela Jacques Lacan : « l’analyse n’est pas une relation à deux dans laquelle l’analyste se désigne comme objet de transfert. Ce qui importe, ce n’est pas une situation relationnelle, mais ce qui se passe dans le discours, c’est-à-dire le lieu d’où le sujet en devenir parle, à qui il s’adresse, et pour qui. »
Elle insiste sur le transfert des parents sur l’analyste, dont il est important de tenir compte car c’est fréquemment la mère qui permet ou empêche qu’un travail se fasse avec l’enfant. Elle insiste beaucoup sur l’introduction des parents dans la cure de l’enfant, dont elle dit que c’est presque devenu une règle chez les psychanalystes avec les enfants de moins de cinq ans, ainsi que dans les cas de psychose. Il faut entendre la parole du parent et de l’enfant du lieu où elle se constitue. « On ne songe guère combien il est vain de vouloir analyser une mère, dit-elle, pour son compte à elle, lorsque son compte à elle est à ce point l’enfant, qu’elle exprime la pérennité de sa présence à travers le symptôme de ce dernier. […] Les psychanalyses séparées de la mère et de l’enfant laissent vierge le véritable terrain où se constitue la parole de l’enfant et de sa mère. [8] » Et plus loin : « j’ai été guidée dans cette étude par l’importance que j’accorde à l’écoute d’un seul discours : celui de l’enfant et de sa famille. »
Elle rend compte aussi dans ce livre d’une expérience intéressante du travail du psychanalyste dans un EMP, travail d’équipe en collaboration avec des collègues psychanalystes.
Le psychiatre son « fou » et la psychanalyse (Seuil, 1970)
Ce livre diffuse l’antipsychiatrie (Ronald Laing, David Cooper) en France à partir d’un travail de recherches menées à Ville-Évrard, Ville d’Avray, Kingsley Hall, avec Ronald Laing, ainsi que Winnicott, la société belge de psychanalyse et l’école freudienne de Belgique.
Selon ses propres mots, elle traite dans ce livre la même question que dans L’enfant arriéré et sa mère, à savoir l’attitude inconsciente collective des « bien-pensants » devant l’« anormal ». Elle dit et cela a toujours été important pour elle et pour nous qui travaillons ou avons travaillé dans des institutions, que la notion même d’« institution » (pour arriérés ou psychotiques) serait à repenser selon des bases théoriques différentes de celles généralement en usage. Elle la remet en cause — ainsi que la psychiatrie et le psychiatre — par rapport à la notion de savoir. Elle se réfère aux travaux de Jean Ayme, Hélène Chaigneau et Jean Oury, pour qui la psychiatrie institutionnelle peut être considérée comme une instance critique de la psychiatrie, de Tosquelles, pour qui l’hôpital est à soigner avant les malades (cf. Enfance aliénée). Quelle place la société et les psychiatres réservent-ils à leurs fous ? Qu’est-ce que la folie ? Freud a répondu en montrant qu’il n’était pas nécessaire d’opposer la folie à la normalité. Elle donne de vifs exemples cliniques de sa pratique et des effets de l’hospitalisation en psychiatrie ou en clinique psychiatrique, ou dans d’autres lieux d’antipsychiatrie. Comment le sujet peut être enfermé dans un diagnostic à vie et devenir cette étiquette. Elle décrit l’institution asilaire, et pose la question : « Est-il possible d’introduire l’institution psychanalytique dans l’institution asilaire et quels sont les effets de l’une sur l’autre ? »
Dans un autre chapitre, elle traite la façon dont l’antipsychiatrie tente de répondre à la maladie mentale et aux problèmes que pose l’obligation de soins. Pour résumer rapidement : « l’antipsychiatrie a choisi de défendre le fou contre la société » et a créé des lieux d’accueil de la folie où la personne suivrait son propre chemin sans vrai processus thérapeutique. Maud Mannoni met en avant la façon dont la psychanalyse aborde la question du sujet et du rapport à la parole. « L’analyste est attentif au contraire à la vérité qui se dégage du discours psychotique »
Un autre chapitre important concerne la psychanalyse didactique et la psychanalyse comme institution. Elle y aborde la question de l’analyse didactique et de l’institution analytique à travers la découverte de Freud, de l’histoire et de la création de la Société de psychanalyse. « L’aveu par Freud en 1914, que ce sont les difficultés surgissant à propos de l’enseignement de la psychanalyse qui sont responsable des dissensions et des scissions, est encore valable de nos jours » écrit-elle[9]. Les premiers pas de Bonneuil y sont aussi relatés.
Préface du livre de Marcelle Faugères et M. D’Argentré : Histoire des deux mères : leur cas n’est pas normal car leur enfant ne l’est pas (Denoël Gonthier, 1970)
Suit une série de 5 livres consacrés à Bonneuil, ce lieu mythique qui était pour moi, dans les années 1968 à la faculté de Nanterre, un lieu de recherche, questionnant la psychiatrie des enfants, comme La clinique de Laborde ou la Chesnay pour les adultes :
- Éducation impossible (Seuil, 1973).
On lira à propos de ce livre l’excellent article de Catherine Vanier-Mathelin qui expose les idées de Maud Mannoni sur l’éducation : « Éducation, oppression, normes » dans Figures de la psychanalyse 2004/2, n° 10, p. 13-24.
- Un lieu pour vivre, les enfants de Bonneuil, leurs parents et l’équipe des « soignants » (Seuil, 1976)
Maud Mannoni refusait que Bonneuil soit un exemple. Ce livre relate des trajets de vie effectués par les enfants et leurs parents, des difficultés, des réussites, qui peuvent éclairer d’autres pratiques en institutions. On y lira les principes de Bonneuil, dialogue entre Guy Seligman et Maud Mannoni, pour introduire le film Vivre à Bonneuil l’institution éclatée, la vie à Bonneuil, des entretiens avec les jeunes, des débats avec les parents, avec l’équipe. Avec des textes de Roger Gentis, Claude Halmos, Robert Lefort, Bruno Mannoni, Marie-José Richer-Leres, Alain Vanier.
- Bonneuil 16 ans après : Comment échapper aux destins programmés dans l’État-Providence, Maud Mannoni et l’équipe des soignants. (Denoël, 1986)
« Jusqu’où peut-on aller dans une compromission avec les contraintes administratives sans pour autant risquer de perdre les raisons d’être d’un travail qui ne prend sens qu’à se soutenir d’un désir de création et de mise en question continue de soi ? Telle est notre question. » Avec une première partie Sur la vie à Bonneuil, avec des textes de Marie-josé Richer Lérès, Philippe Pétry, Marianne Beaumont ; et une deuxième partie sur La vie en province : le service de suite. Avec des trajets des enfants et adolescents dans et hors Bonneuil, « Ce qui insiste dans ce trajet, c’est le « vécu » d’une expérience commune impliquant les « psy », les enseignants, les éducateurs, les enfants, leurs parents, sans oublier les artisans et paysans qui les accueillent » Textes de Martine Rosati, Chandra Covindassamy, Michel Polo et les correspondances de Maud Mannoni avec les autorités nationales et Locales.
- Enfance aliénée (l’enfant, la psychose et l’institution), présentation de Maud Mannoni, Recherches, 1967, Union générale d’éditions 71/1/1972, Denoël, 1984.
Ce recueil contient une partie des textes présentés aux « Journées d’études sur les Psychoses chez l’enfant » (Paris, 21-22 octobre 1967) autour de Laing, Cooper, Winnicott, Lacan, publié dans Enfance aliénée (septembre 1967) et Enfance aliénée II (décembre 1968). Textes de Xavier Audouard, David Cooper, Jean Faure, R. et R. Lefort, R. D. Laing, Maud Mannoni, Ginette Michaud, Edmond Ortigues, Jean Oury, Ginette Rimbault, Anne Lise Stern, René Tostain, D.W. Winnicott et Jacques Lacan.
- Secrète enfance, (les enfants de Bonneuil et les parents prennent la parole), Maud Mannoni et Guy Seligman, EPI, 1979
À partir de documents, pour la plupart inédits, dont a été tiré le film Secrète Enfance. Aux récits des enfants et des parents se mêlent les paroles des familles d’accueil en province.
- Les mots ont un poids ils sont vivants, que sont devenus nos enfants « fous » ? (Denoël, mars 1995)
Bonneuil menacé, déjà ! L’accueil des enfants psychotiques suivis jusqu’à l’âge adulte, et au-delà. L’écoute des enfants autistes, un ailleurs, le travail extérieur, les lieux d’accueils, la province, les artisans, un long et difficile parcourt vers une réinsertion dans le monde « normal », illustré par de nombreux cas cliniques. Tout cela menacé par des circulaires administratives qui ne tiennent pas compte des personnes.
Amour, Haine, séparation : Renouer avec la langue perdue de l’enfance (Denoël, 1993)
Dans ce livre très riche et foisonnant, Maud Mannoni aborde des thèmes qui lui tiennent à cœur, notamment l’effet du traumatisme chez ceux qui l’ont subi. Certains ne peuvent sortir de la répétition sans possibilité d’invention, alors que d’autres se libèrent à travers la création artistique, la création littéraire, tels les écrivains Edgar Poe, Edith Wharton ou H. Ch. Andersen.
Les thèmes de la solitude et de l’inquiétante étrangeté, se retrouvent chez les cinéastes comme Hitchcock, fasciné par Poe. Chez Bergman, c’est plutôt celui du trauma psychique : terreur, horreur, panique. Avec Freud et Winnicott, elle théorise ces situations faisant référence à la notion de jeu, où la peur est déplacée sur L’Autre scène. C’est ce qui se pratique à Bonneuil avec le théâtre (référence à Artaud et Grotowski).
Elle écrit des pages très fortes et justes sur les survivants des camps nazis, sur les enfants disparus après le coup d’État des militaires en Argentine, le silence, le trou dans l’histoire et la difficulté à communiquer ce vécu pour les survivants. « Il a perdu l’espoir de pouvoir un jour être entendu », écrit-elle. Comment survivre au Trauma et arriver à jouer avec leurs enfants sans être étouffé par les règles contraignantes comme celle des camps, où le survivant est en proie à la haine et à la mort ? J’ai pensé à la BD Maus d’Art Spiegelman.
Dans le séminaire « Lire Maud Mannoni » consacré à ce livre, présenté avec beaucoup de clarté par M. P. Mansuy[10], Catherine Vanier nous rappelait que, pour Freud la haine, c’est le premier affect, avant l’amour et la séparation d’avec l’autre, qui permet de transformer cette haine. Le livre se déploie avec l’Histoire et des histoires, avec les écrivains, éclairé par les références à Lacan, Freud, Winnicott et Octave Mannoni.
La théorie comme fiction, Seuil, 1979
Un livre polémique qui revient sur la psychanalyse et l’institution, Maud Mannoni met en garde sur le fait que la théorie peut devenir comme une défense chez l’analyste par rapport à ce que dit l’analysant. Elle fait une grande part à Winnicott, à l’invention et à l’espace de jeu… et revient sur la fin de l’analyse.
D’un impossible à l’autre, Seuil, 1982
Maud Mannoni y éclaire la pratique de l’analyse par son expérience dans la cure des enfants autistes, cette part de l’inanalysable, et par sa réflexion sur le respect de la limite de l’analyse comme chez Freud et Winnicott. Elle l’illustre par l’exemple de Kipling : après avoir vécu dans son enfance le drame de la séparation d’avec sa mère et sa culture en Inde, il est parvenu à le surmonter et à en nourrir sa création. L’écrivain raconte cette expérience dans son livre autobiographique « Something of Myself ».
Le livre se termine par un hommage à Françoise Dolto : « Quarante ans d’une parole ». Elle y insiste sur sa méthode : « c’est l’attention portée au contexte et à la langue parlée par le patient qui va constituer l’axe autour duquel s’ordonne la démarche de Françoise Dolto. »
Le Symptôme et le savoir, (Seuil, février 1983)
Sa soutenance de thèse de doctorat d’État, faisant de cette soutenance un symptôme face au savoir. Soutenue le 13 mai 1982 à Paris VII devant un jury composé de Julia Kristeva (présidente), Pierre Fedida (directeur des travaux), Pierre Kaufmann, Lucien Israël, Jean Oury.
Maud Mannoni préface Libres enfants de Summerhill d’Alexander S. Neill, publié chez Maspero en 1983, qui retrace les théories pédagogiques de Neill fondées sur la liberté et l’autogestion. On n’obligeait pas les enfants à travailler, une grande part étant faîte aux jeux et aux arts. Cette expérience eu un grand retentissement en France et je crois que, bien que menacée de disparaître, cette école existe toujours et est dirigée par la fille de son fondateur.
Création de la collection « Espace analytique » chez Denoël (1983)
Un savoir qui ne se sait pas (1985)
Cet ouvrage contient notamment une partie historique, avec la redécouverte de certains textes psychiatriques et psychanalytiques. On y trouve un entretien entre Octave Mannoni et Jacques Lacan sur les enjeux de la psychanalyse, sur la psychanalyse d’enfant (en quoi la technique de Dolto se différencie-t-elle de celle de Lebovici ?) et sur l’enseignement de la psychanalyse, la didactique. Sa postface est rédigée par P. Guyomard.
Ce qui manque à la vérité pour être dite (1988)
Comment devient-on une psychanalyste nommée Maud Mannoni ? Témoignage sur son trajet de vie qui l’a conduite à la psychanalyse.
Un livre qui ne nous laisse pas en repos et qui est aussi un hommage à l’écriture, aux écrivains et à l’édition comme le disait Olivier Douville lors du séminaire du 10/03/21, sur ce livre, citant cette phrase « l’écriture ne me lâche plus ». Maud Mannoni y évoque les ruptures et la psychanalyse, d’abord en Belgique, puis les rencontres heureuses avec Dolto, Octave Mannoni, Lacan, Winnicott et quelques autres. De Freud, aux analystes d’Argentine et d’Uruguay. Elle relate le voyage qu’elle fit dans ces pays avec Octave en 1972, la dictature qui y a sévi, tuant sans sépulture, les milliers de « disparus » et les enfants nés en captivité, adoptés par les bourreaux des parents. Maria Otero Rossi nous a longuement détaillé le voyage en Argentine d’Octave et Maud Mannoni dans le cadre du séminaire « Lire Maud Mannoni » tenu en 2023.
On y lit le combat incessant de Maud Mannoni contre la ségrégation et la violence, évoquant Dickens pour parler des jeunes en rupture avec la société. Le pari de Bonneuil : « ce qui domine c’est l’invention des adultes… pour aider chaque adolescent à passer du statut d’handicapé au statut d’adulte normal. » Cela pose la question de la politique de la santé mentale en France.
En annexe, des documents inédits autour des scissions, des lettres de Jacques Lacan à Maud Mannoni, ainsi que l’appel du 28/06/1982 pour la fondation du CFRP.
De la passion de l’Être à la « Folie » de savoir (Freud, les Anglo-Saxons et Lacan (1988)
Sur la formation du psychanalyste, et le passage à l’analyste. « Une seule et même question insiste tout au long de ce livre : qu’est-ce qui au cours du trajet d’un analysant, fait de lui un analyste ? » Écrit-elle dans un avant-propos percutant et questionnant concernant l’analysant, le dire vrai, le désir de l’analyste. Livre que Maud Mannoni dédie à la communauté des analystes qui a soutenu son questionnement. Puisqu’une partie du livre a fait l’objet de débats lors de journées d’études du CFRP, où elle aborde les questions cruciales de la formation, des institutions psychanalytiques, la didactique, le contrôle, la fin de l’analyse, la vérité à retrouver dans la parole, les formations de l’inconscient. Elle ne nous livre pas un prêt à l’emploi, un modèle, mais elle interroge l’expérience avec le patient : apprendre du patient en référence à Winnicott, ce qu’on apprend de nos échecs. Là encore les écrivains ouvrent une voie, celle de la fantaisie avec celle de Cervantès et le conte de l’homme au sable D’Hoffman. Un livre tout à fait original, et qui s’accompagne d’une Postface d’Alain Vanier et P. Guyomard, sur la notion d’Institution analytique.
Le nommé et l’innommable, le dernier mot de la vie, pour Octave Mannoni (1991)
Un livre bouleversant sur la maladie, la vieillesse, la fin de vie, aux problématiques toujours actuelles. Un livre de combat comme tous les livres de Maud Mannoni, écrit après la mort d’Octave Mannoni, l’écriture comme moyen de lutter. « Un livre qui nous secoue, important, très documenté, un livre d’analyste, des rappels de la théorie analytique avec Freud, la maladie et la mort, Lacan. »
Livre que Catherine Vanier nous présente dans le séminaire « Lire Maud Mannoni » du 12 avril 2021, en relevant tous les thèmes importants soulevés par Maud Mannoni tant historiques qu’analytiques quand Freud parle de la vieillesse. Nous partageons la fin de vie d’Octave Mannoni à travers cette lecture émouvante et rageuse, avec les derniers mots d’Octave. La révolte aussi de Maud Mannoni qu’on retrouve dans tous ses livres et sa lutte infatigable contre les ségrégations des fous, des enfants fous, des migrants et des vieux. C’est un livre militant et politique sur le statut des vieux et des malades, des improductifs rejetés par notre société dans des mouroirs (cf. les scandales encore récents dans certains Ehpads). Les écrivains toujours : Tolstoï (La mort d’Ivan Ilitch, Shakespeare (Le roi Lear). Ce livre, comme la plupart de ses ouvrages, est émaillé de citations d’Octave Mannoni, son compagnon de vie, de route, d’idées et d’engagement.
Amour, haine, séparation (1993)
Maud Mannoni interroge les destins du traumatisme (voir plus haut).
Les mots ont un poids, ils sont vivants : Que sont devenus nos enfants « fous » ? 1995 (voir plus haut).
Enfin, son dernier livre paru quelques mois avant sa mort : Elles ne savent pas ce qu’elles disent (1997).
Un livre là encore très engagé sur la condition féminine, un immense travail sur Virginia Woolf, sa vie, son œuvre, sur son combat pour la liberté des femmes, dénonçant le modèle patriarcal et l’idéologie fasciste montante, dans un dialogue et un débat avec la pensée de Freud, de Mélanie Klein, que Maud Mannoni nous fait découvrir. À la question de Freud « Que veut la femme ? » Virginia Woolf répond être et non pas avoir le pénis, (et Lacan répond : « Elle désire ») « Le romancier apprend par le dedans de lui-même ce que l’analyste apprend par les autres. » (Freud) C’est aussi la place de la femme dans notre société qui est étudiée, soit par l’identification à l’homme soit en se cherchant au niveau de l’être et en se réinventant avec l’autre. Elle se réalise dès lors de façon créative en épousant la révolte plutôt que la chose établie : « Ce sont les racines inconscientes de ce racisme (anti-femme) que ce livre a tenté d’évoquer, en s’appuyant sur les romanciers et les poètes. »
Un livre en anglais, Separation and Creativity: Refunding the lost language of Childhood, Maud Mannoni and Susan Fairfield, ed. Other Press, 31/03/1999.
Dans sa collection qu’elle dirigea chez Denoël et qu’Alain Vanier reprit après sa mort, Maud Mannoni publia de nombreux livres de psychanalystes, CFRP, Espace ou d’autres groupes, Joël Dor, M.-C. Lasnick, Octave Mannoni, Catherine Vanier, etc., et quelques livres sur la violence de notre monde, tels que :
Exil et torture de Maren et Marcelo Viñar, sur la torture en Uruguay, dont elle écrit la présentation (1989).
Il n’y pas de saison pour la mort, Auschwitz-Birkenau, Dachau, Varsovie, de Catherine Saladin (1997).
De nombreux livres de Maud Mannoni sont traduit au Brésil, en Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, et Grèce.
Autres livres collectifs
Enfance aliénée (Denoël, 1984) à partir des journées sur les Psychoses des 21-22/10/1967, publié dans la revue Recherches, déc. 1968 : Spécial Enfance Aliénée, I et Spécial Enfance Aliénée II, n° 7 et 8 : « L’enfant la psychose et l’institution », introduction et conclusion de Maud Mannoni, conclusion de J. Lacan.
- « Psychothérapie des psychoses », Maud Mannoni, I, p. 47.
- « Psychanalyse et Pédagogie » de Maud Mannoni et Moustapha Safouan, I, p. 175.
- Préface de l’édition de 1984 (Maud Mannoni)
- Présentation à l’édition de 1972 (Maud Mannoni)
Conversations psychanalytiques, Xavier Audouard, Michel de Certeau, Joël Dor, Maud Mannoni, Octave Mannoni, Ginette Michaud, François Tosquelles, Paris, Hermann, 2008.
La crise d’Adolescence, présentation par Maud Mannoni, Denoël, 1984.
Travail de la métaphore, identification, interprétation, Denoël 1984, présentation
Le moi et l’Autre, présentation par Maud Mannoni, Denoël, 1985.
Le divan de Procuste, le poids des mots, le mal-entendu du sexe, Denoël, 1987, présentation de Maud Mannoni : contribution d’Octave Mannoni qui ouvre les textes cliniques autour de la direction de la cure et les débats, avec son texte sur le Divan de Procuste, dans lequel il souligne l’écart entre rééducation et psychanalyse (conférences du CFRP), avec les textes de Denis Wasse, Laura Dethiville, Joyce Mc Dougall et un dernier texte d’Octave Mannoni consacré au langage schizophrénique.
Devenir Psychanalyste, les formations de l’inconscient, présentation de Maud Mannoni (Denoël, Paris 1996) dans laquelle elle note la contradiction entre institution et psychanalyse et pose la question comment « protéger la psychanalyse des analystes » sinon « Ce qui fonde ce discours, c’est le rapport que l’analyste (et l’analyste en devenir) entretien avec « le travail » de l’inconscient ». « Comment faire pour qu’au fil des ans un discours analytique ne devienne, par des effets de distorsion, une langue morte et comment préserver le vif de l’inconscient ? » avec les témoignages de leur parcours singulier d’Arlette Costecalde, Ignacio Garaté Martinez, Denise Lachaud, Cosimo Trono. Postface de Patrick Delaroche et Alain Vanier
Psychanalyse et Politique, livre collectif sous la direction de A. Verdiglione, issu du colloque « Pychanalyse et Politique » (Milan, 1973), Seuil, 1974.
Le débat : Malaise dans la civilisation ? Collectif, Gallimard, 1983.
Deligny et les tentatives de prise en charge des enfants fous : l’aventure de l’Aire (1968-1973) de J.-P. Guillemoles, Erès, 2007.
Maud Mannoni et Rose-Marie Guérin, de Yves Guérin et Jean Pax, L’Harmattan, 2022.
Fécondité d’une rencontre entre psychanalyste et éducation spécialisée. Un livre très précieux et très vivant.
À propos de la visite de Maud et Octave Mannoni en Argentine et en Uruguay en 1972 : nous avons retrouvé :
«Visita de los profesores Maud et Octave Mannoni de la escuela freudiana de Paris. Intercambio científico realizado en la Asociación psicoanalítica uruguaya, abril 1972. Une publication de l’association Uruguayenne de psychanalyse ( archives d’Espace analytique).
« Maud Et Octave Mannoni, el estallido de las institutiones », Cuadernos Sigmund Freud, 2/3, Buenos Aires, déc. 1972 (archives d’Espace analytique).
Maria Otero Rossi les a présentés au séminaire « Lire Maud Mannoni » le 12 avril 2023 à Espace analytique. En compagnie de Victor Fishman qui fut l’interprète de Maud et Octave Mannoni lors de leur voyage en Argentine. Elle a rédigé l’article « La visite de Maud et Octave Mannoni en Argentine, 1972 », Figures de la Psychanalyse.
Articles de Maud Mannoni, publiés ou inédits :
« Contribution à l’étude du problème de l’agressivité chez le garçon » Psyché, revue internationale de psychanalyse et des sciences de l’homme, n° 65, 1952, p. 187-203 (bibliothèque Sigmund Freud ; SPP).
« L’enfant désobéissant » l’École des Parents et des éducateurs, Paris, 1951.
« Contribution à la psychologie des mères adoptives », Association des psychanalystes de Belgique, Bulletin d’activités n° 20, annexe, juillet 1954.
« Réactions de la famille à la débilité », Association des psychanalystes de Belgique, Bulletin d’activités n° 22, annexe, avril 1955.
« L’enfant qui reste un bébé » 01/01/1958, illustration de Geneviève Godron.
« Le malentendu de Mannoni » L’ARC, n° 58 (Lacan) 1/1/1958.
« L’enfance handicapée : la débilité en question » Esprit, n° 343, 1965.
« La psychothérapie des psychoses », Journées des centres psychopédagogiques, mai 1966, chap. 3, publié par le Centre Claude Bernard avec le concours de l’Institut Pédagogique National. Texte repris dans L’enfant sa maladie et les autres, Seuil, 1967.
« Psychothérapie des psychoses » Recherches, spécial enfance aliénée 1, sept. 1967, p. 47.
« Psychanalyse et Pédagogie, Maud Mannoni et Moustapha Safouan », Recherches, spécial enfance aliénée 1, sept. 1967, p. 175.
Lettre à Simone de Beauvoir, lettre manuscrite de mai 1967 (BNF, Archives de Simone de Beauvoir, cote : NAF 82501).
« La révolution de mai et la psychanalyse » (à paraître en anglais chez Penguin Books 1968 ?), manuscrit consultable aux archives d’Espace analytique.
« Problèmes posés par la psychothérapie des débiles » (XVe congrès de l’UNAR, Paris 16-18/11/1964), in Sauvegarde de l’Enfance, n° 1, 2, 3, 1965, p. 100-108 ; compte rendu dans le Bulletin de Psychologie, 1968, tome 22 n° 274, p. 299. Techniques médicales et rééducatives spécialisées dans le traitement de l’insuffisance mentale.
Maud Mannoni a rédigé deux chapitres de L’éducation quotidienne, ed. Colin Bourrelier, 1969 :
chap. 3 : Faisons-les grandir : S’il reste un bébé.
chap. 6 : Comprenons son opposition : S’il est désobéissant.
« L’école expérimentale de Bonneuil/Marne » Le Coq Héron, n° 3, janvier 1970.
Un article de Maud Mannoni, La Quinzaine littéraire, 1-15 mars 1971, n° 113.
« L’administration de la folie en question » Partisans, n° 62/63 (Folie pour Folie), février 1972, p. 207-212, suivi par des documents p.213-215.
« Les femmes aujourd’hui, demain », CERM, semaine de la pensée marxiste (29/01-04/02/1975).
« Le produit d’une expérience : sur le livre de Lucien Israël Initiation à la psychiatrie (Masson) », La Quinzaine littéraire, 16/11/1984.
« Entrevue : Maud Mannoni, un lieu pour vivre », Ornicar ? bulletin du Champ Freudien, n° 8, hiver 1976/77, p. 93-101.
Interview de Maud Mannoni par Gérard Miller dans Entrevue, 30/09/1976 à propos de son livre Un lieu pour vivre.
« Entretien de Maud Mannoni avec Ch. Descamps », ARC, n° 78, 1980 (Georges Groddeck)
« Maud Mannoni : Roger Gentis contre les nouvelles thérapies : il y voit une mystification et une exploitation commerciale », Le Monde, 23/05/1980.
« Invalidation : Maud Mannoni », Le Débat, n° 24, 1983/2, p. 40-41.
« L’institution soignante », Les cahiers de l’IPC, article, 1985
« Réponse à l’enquête : Quel avenir pour la psychanalyse en psychiatrie ? » Psychiatrie française, n° 1, vol 17, 1986, p. 12-13.
« Entretien : Maud Mannoni et Mario Cefali », 8/4/1988, Bloc-Notes de la psychanalyse, n° 8, 1988.
« Inédits de Maud Mannoni » Logos-Ananké n° 1, 1999 (La différence sexuelle) :
- « Donald Woods Winnicott. Londres, les années soixante. Témoignage d’un trajet », présenté par Dominique Caïtucoli, p. 123-145.
- « Entretien avec Ignacio Garaté- Martinez », ibid., p. 147-168.
Dans cet interview, Maud Mannoni répond à une question sur son style et la joie : « Disons que c’est une façon de pouvoir, en vieillissant, ne pas perdre le rapport à l’enfant en soi. Cette dimension de vie et de création se ressource dans l’enfance. Chacun naît d’un drame et il y a des drames qui laissent ouvertes des possibilités de création dans lesquelles se sourcent certaines joies de vivre. Il y a des traumatismes qui amènent des défenses telles que les gens se trouvent davantage en identification avec une image d’adulte respectable ; généralement, chez ces gens-là, ce qui leur a été volé c’est leur enfance. Ils ont été des grandes personnes beaucoup trop tôt. »
« Psychanalyse et handicap » Logos-Ananké n° 2/3, 1999-2000, p. 289, présenté par Johan De Groef, pour un colloque à Blankenberge en Belgique.
« Entretien avec Maud Mannoni » dans Quartier Lacan, p. 171-180 (Alain Didier Weil, Alain Vanier) auteurs Emil Weiss, Alain-Didier Weill, Florence Gravas, 2010.
« Entretien Maud Mannoni – Émile Malet » pour la revue Passage (1996) ? manuscrit consultable aux archives d’Espace analytique
Maud Mannoni a participé à de nombreux colloques et donné des conférences qui ont donné lieu à des publications comme celles contenues dans son livre L’enfant sa maladie et les autres.
Principaux articles de Maud Mannoni dans des revues psychanalytiques :
« Fantasme et corps fantasmé », Psychanalyse (revue de l’APF), n° 8, 1964, PUF.
« Enseignement et compétence », intervention aux journées d’étude sur l’enseignement des 24- 25/04/1982, décembre 1983, Esquisses psychanalytiques (Bulletin du CFRP) n° 1, p. 23, republié dans Figures de la psychanalyse, Formations de l’analyste n° 20, 2010/2, p. 153-161, Érès.
« Entretien avec Maud Mannoni » par Lenio Rizzo, 1982, Figures de la psychanalyse, n° 14, Erès, 2007.
Dans cet interview, Maud Mannoni retrace son parcours et ce qui a présidé à la création de l’École expérimentale de Bonneuil. Puis elle donne sa lecture critique de l’échec de l’École freudienne de Paris et de l’expérience de la Passe. Elle présente son livre D’un impossible à l’autre.
« La théorie et ses enjeux », table ronde du 26/11/1983 au CFRP, Esquisses psychanalytiques, n° 2, automne 1984.
« Psychanalyse et politique de la santé mentale », hors-série n° 1, septembre 1989, Esquisses psychanalytiques, introduction et conclusion (journée d’études du CFRP du 04/12/1988)
« Risque et chance de la supervision », Études Freudiennes, n° 31, 1989 (journées d’Études Freudiennes 16/17 mars 1985).
« Éléments du débat sur le projet d’une ‘’instance ordinale’’ des psychanalystes », introduction de Maud Mannoni au débat (table ronde du CFRP, 20/01/1990) Esquisses psychanalytiques, n° 13, printemps 1990. Numéro d’hommage à Octave Mannoni avec une bibliographie de ses travaux.
« Sur Colette Audry » Esquisses psychanalytiques, n° 14, automne 1990.
« L’enfant et la psychanalyse », textes du congrès « L’enfant et la psychanalyse. Questions contemporaines », 02-05/04/1992, « Pour conclure » par Maud Mannoni, p. 605-611.
« Dossier : Faut-il haïr Lacan », Passages, n° 57, 1993.
« Clinique des phobies », Esquisses psychanalytiques, n° 21, septembre 1994 : En guise d’introduction (Journées de Bordeaux, 26-27/03/1994 : phobie symptôme ou structure).
« Hommage à Irène Roublef », Esquisses psychanalytiques, n° 20, mars 1994.
« Rapport Massé : en guise de commentaire », dans le même numéro.
« Présentation de l’exposition des dessins d’enfants de l’ex-URSS », Esquisses psychanalytiques : Psychanalyse latino-américaine, n° 22, mai 1995, à l’occasion de la journée organisée par l’association Perenos/Transfert : « Lire l’histoire à travers les dessins d’enfants (07/12/1993) »
« Correspondance entre Dolto et Mannoni », éditée par Muriel Djerebi-Valentin, dans Françoise Dolto, une vie de correspondance : 1938-1988, Gallimard, coll. Fr. Dolto, 2005.
« La santé Mentale à l’abandon », entretien avec Maud Mannoni par Patrick Conrath, Journal des Psychologues, Dossier : Penser la psychanalyse d’hier et d’aujourd’hui, n° 339, 2016, p. 36-38.
Articles publiés à propos de ses livres, ou après sa mort
Commentaire de Jacqueline Cosnier sur L’enfant arriéré et sa mère, Revue française de Psychanalyse, vol 29, n° 2-3, 1965.
« L’éducation impossible Maud Mannoni », Georges Mauco, Revue Française de Psychanalyse, vol. 38, n° 4, 1974.
« Enfance administrée », Georges Mauco, ibid., p. 193-200.
À relire pour l’intérêt de ce livre et pour la première partie : « Le premier rendez-vous avec le psychanalyste… trente ans après » in Raisins verts et dents agacées, de Catherine Mathelin-Vanier, Denoël 1994.
« Hommage à Octave et Maud Mannoni », in Où en est la psychanalyse ? psychanalyse et figures de la modernité, Érès, 2000, avec des textes de Claude Boukobza Fanny Colonomos, Catherine Mathelin Vanier, Guy Sapriel.
« Maud Mannoni », sous la direction de Nicole Maya Mallet, JFP n° 10 Érès, 2000, avec des articles de C. Covindassamy C. Boukobza, M. David, Jean Ayme, G. Michaud, J. Sédat, A. Vanier, C. Vanier.
« Mannoni Van Der Spoel, Maud », Jacques Sédat, in Alain de Mijolla, Dictionnaire international de psychanalyse, p. 965, Calmann-Levy, 2002.
« Psychanalyse et anti-psychiatrie », Alain Vanier, Topique vol. 88, n° 3, 2004, p. 79-85.
« Clinique des psychoses en institution à l’éclairage de l’expérience de l’école expérimentale de Bonneuil », Dominique Caîtucoli, Figures de la psychanalyse n° 14, 2006/2, p. 83-100.
« Maud Mannoni et les éveilleurs d’humanité », Laure Thibaudeau, Psychanalyse vol 15, n° 2, 2009, p. 101-111.
« Maud Mannoni et l’institution éclatée », Elisabeth Roudinesco, Actualités de la psychanalyse, Érès, 2014, p. 16-20.
« Actualité de Maud Mannoni », Martine Sgambato, Actualités de la psychanalyse, Érès , 2014, p. 256-261.
« L’actualité de l’expérience de Bonneuil avec et après Maud Mannoni », Dominique Caîtucoli, Actualités de la psychanalyse, Érès, 2014, p. 65-71.
« Maud Mannoni : nos premiers pas », Liliane Donzis, Figures de la psychanalyse n° 29, 2015/1 p. 159-161.
« La santé mentale à l’abandon, Maud Mannoni » entretien mené par Patrick Conrath, Le journal des psychologues, 2016/7 n° 339 p. 36-38.
« Marque, passe et tresse », Pierre Bruno, Figures de La psychanalyse, n° 37, 2019/1, p. 175-186.
« Maud Mannoni : apprendre une autre langue », Maria Izabel Oliveira Szpacenkof, Figures de la psychanalyse n° 20, 1/2020, p. 163-176.
« Maud Mannoni (1923-1998) », Alain Vanier, Encyclopædia Universalis
« Trajet de Maud Mannoni », Alain Vanier, éditorial du site d’Espace analytique, sept. 2018, repris du JFP n° 10, 2e trimestre 2000.
Alain et Catherine Vanier parlent de Maud et Octave Mannoni et de Bonneuil au séminaire de Marcos Zafiropoulos « Clinique de la Culture et de la Modernité » le 14/4/2016. À écouter sur le site d’Espace analytique.
Deux articles parus dans la presse après son décès :
« Maud Mannoni dans la nuit », Antoine de Gaudemart Libération 17/3/1998.
« Maud Mannoni un lacanisme à visage humain », Elisabeth Roudinesco, Le Monde, 18/3/1998.
A la bibliothèque d’Espace analytiques, vous pouvez trouver ces ouvrages, les consulter, les emprunter sous certaines conditions.
Émissions de radio et télévision
« Les troubles du caractère : témoignages de parents et de psychanalystes : Maud Mannoni, Françoise Dolto, Charles Melman », France Culture : Recherche de notre temps, 16/02/1965. INA.
« Entretien avec Jean Paget sur l’anti-psychiatrie », à l’occasion de la sortie de son livre Le psychiatre, son « fou » et la psychanalyse, France Culture les 10 et 17/09/1970, (une série d’émission sur l’antipsychiatrie « Arcanes 70 » de Roger Pillaudin rediffusée le 09/07/2020 et le 14/08/2023 dans Les nuits de France Culture) : Maud Mannoni expose ce sur quoi se fonde sa contestation de la psychiatrie, une remise en question du savoir sur la folie. « Changer la mentalité collective à l’égard de la folie, trop simple d’ouvrir simplement les portes de l’asile, généraliser la possibilité de lieu d’accueil, de vie, où les gens seraient peu nombreux ». Elle décrit la vie à Bonneuil : « Bonneuil un lieu d’accueil ou l’on vit une expérience de vie communautaire qui pourrait s’appliquer aux adultes, avec l’organisation de la vie de la maison, on fait les courses, la cuisine … les portes sont ouvertes, c’est un lieu d’accueil, un lieu de passage ou l’on n’est pas « refait comme un rat, » on laisse cette possibilité de fuite à l’extérieur, …. Le problème de la ségrégation est au cœur de nous-même comme la folie. » les échanges et le travail avec Fernand Deligny dans les Cévennes « il écrit dès 1928 : le milieu est langage ou n’est pas […] Les choses doivent pouvoir s’inscrire dans le sens de la vie et non contre elle. »
« Freud Freud N Freud Aisne Freud-haine freudines freudaines ? » Dimension 3 sur FR3 le 20/04 /1987 (55’) INA, documentaire consacré à la psychanalyse à travers les interviews de plusieurs personnalités dont M. Hayat, Felix Guattari, Elisabeth Roudinesco, Maud Mannoni.
« Semaine spéciale psychanalyse : Comment d’analysant devient-on psychanalyste ? Maud Mannoni », Mise au point, France culture, 5/4/1988, INA Radio France, autour de son livre De la passion de l’Être à la « Folie » de savoir.
« Le bon Plaisir », France culture, 11/1/1992, INA ; (3 h d’émission enregistrée chez elle, à Bonneuil au gré de ses rencontres et activités ; discussion avec son amie d’enfance Liliane Van der Kerkove, avec l’écrivaine Viviane Forester, avec Hélène Mannoni, et une interview de Guy Seligman. Elle parle de sa formation de psychanalyste, de son travail avec les enfants autistes et d’Octave Mannoni.
La BNF propose un podcast sur une série de conférences sur les Figures féminines de la psychanalyse en France. La première, présentée par Elisabeth Roudinesco, dresse un panorama des femmes psychanalystes dans le XXe siècle. La quatrième, Maud Mannoni, la psychanalyse, l’institution et les marges, est animée par Claudia Maier-Höfer en avril 2022. Elle a connu Maud Mannoni en 1990, et a fait sa thèse de doctorat sur elle, qui n’est pas traduite en français. En 1997, elle réalisé une série d’entretiens chez Maud Mannoni rue Ferdinand Buisson, publiés en Allemagne en 1998 : « Tout savoir n’est en fait que politique… Le savoir particulier de Maud qui lui a permis d’émerger, dialogue avec ses joies, ses peines avec une place pour la créativité et l’imagination. Cf. la soutenance de thèse de Maud Mannoni : le symptôme et le Savoir […] Virginia Woolf, lorsque le jeu et le contre jeu d’une personne stable fait défaut, quand fait défaut l’intérieur, l’extérieur se détache… »
Films
Participation au film Enfance africaine réalisé par Jacques Baratier, 1976, Antenne 2 et Unicef. (Diffusé sur A2 le 16/01/1977) Maud Mannoni, Octave Mannoni, Georges Niangoran-Bouah auteurs de l’œuvre originale. Un document consacré à l’éducation des enfants senoufo de la région de Korhogo en Côte d’Ivoire depuis leur naissance jusqu’à l’école. Cette éducation qui est une initiation à la vie, amène les enfants à prendre très tôt conscience de leur rôle dans la société traditionnelle. Georges Niangoran explique : « dès la naissance, l’éducation des filles et des garçons est séparée, les filles seront éduquées aux tâches ménagères par leur mères ; les garçons se répartissent en classe d’âge et règlent eux même leurs problèmes. Cependant, ils sont sous l’autorité totale du chef du village, le respect et l’aide aux Anciens est un devoir pour les enfants. Octave et Maud Mannoni ont comparé ce système au système occidental, pour eux c’est davantage de l’éducation que de l’enseignement. L’enfant est initié à la vie, on lui laisse des responsabilités. Sur le plan religieux, les enfants servent à montrer la bonne santé du village, auprès des ancêtres, voir à écarter le mauvais sort. » (Institut français, département cinéma 2015-51, cinémathèque Afrique, magasin- salle. P- numav 850413, et INA.)
Dans le coffret « Françoise Dolto », trois films réalisés par Elisabeth Coronel, et Arnaud de Mézamat, ed. Gallimard/Abacarris films, 2005. Le coffret contient « Maud Mannoni évocations » entretien avec Maud Mannoni, 1993, 22’ INA, qui évoque ses rencontres avec Françoise Dolto et témoigne de son propre engagement dans les prises en charges thérapeutique des enfants.
Vivre à Bonneuil, de Guy Seligman sur l’école expérimentale de Bonneuil, 1974 (diffusé sur TF1 le 14/05/1975).
Secrète enfance (de Guy Seligman 1977, diffusé sur TF1, le 28/03/1979). Bonneuil, la vie en province, la parole des enfants, des parents et des familles d’accueil.
Les deux films de Guy Seligman ont été projetés à Espace analytique.
Sans savoir pourquoi, film d’animation, INA, diffusé 01/01/1988, documentaire : une série de dessins et de peintures, réalisés par des enfants de l’école expérimentale de Bonneuil, à l’origine d’un dessin animé fortement imprégné de leur imaginaire.
[1] Jacques Lacan, Le séminaire, livre XI, Les quatre concepts de la psychanalyse, Seuil, p. 215.
[2] Ce qui manque à la vérité pour être dite, p. 42.
[3] Ibid., p. 42, puis 124.
[4] P. 14, 15,16.
[5] L’enfant arriéré et sa mère, p.185.
[6] Le premier rendez-vous…, p. 53.
[7] L’enfant sa « maladie » et les autres, p. 61.
[8] Ibid., p. 57 puis 122.
[9] Le psychiatre, son « fou »…, p. 202.
[10] Séminaire du 09/06/1921.